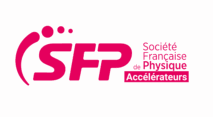Covid-19 : les grandes infrastructures de recherche s’organisent
Pour faire face à la crise sanitaire du COVID-19, les infrastructures de recherche du CNRS ont dû s’adapter : la plupart ont fermé leurs portes mais certaines doivent maintenir une activité essentielle. Conséquence directe de la pandémie, la plupart des infrastructures de recherche et très grandes infrastructures de recherche (TGIR) ont réduit leurs activités au […]
Covid-19 : les grandes infrastructures de recherche s’organisent Lire la suite »