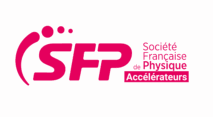Qu’est ce que le prix Jacques Haïssinski ?
Le prix Jacques Haïssinski est destiné à récompenser une personne ayant soutenu une thèse remarquable dans la discipline. Il est remis tous les deux ans lors des Journées Accélérateurs et est ouvert à toutes les personnes ayant soutenu une thèse dans la discipline moins de deux ans avant le 31 décembre précédent l’édition en question des Journées Accélérateurs de Roscoff. Le prix sera décerné pour la première fois lors des Journées Accélérateurs qui se tiendront du 7 au 10 octobre 2025.
Rendez vous sur cette page du site de la SFP pour déposer une candidature.
Historique du prix
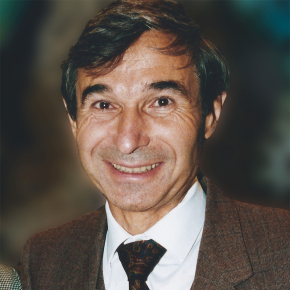
Jacques Haïssinski (1935-2024) était un physicien français dont les travaux ont marqué les domaines des accélérateurs mais aussi de la physique des particules et de la cosmologie. Sa carrière scientifique débute au Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire à Orsay, où il contribua à la mise en œuvre des premières collisions électron-positon dans l’anneau AdA, pionnier dans le domaine. En 1967, il formula l’« équation de Haïssinski », décrivant l’équilibre longitudinal dans un anneau de stockage, devenue une référence dans le champ des accélérateurs.
Au cours de sa carrière, il exerça d’importantes responsabilités : porte-parole de l’expérience CELLO à DESY, directeur adjoint scientifique de l’IN2P3, directeur du DAPNIA au CEA/Saclay et président du comité des expériences du LEP au CERN. Il s’engagea dans la conception et la réalisation du projet ThomX, une source compacte de rayons X par diffusion Compton installée à IJCLab. Professeur à l’université Paris-Sud, Jacques Haïssinski se distingua aussi par son engagement dans la diffusion de la culture scientifique, notamment à travers Sciences-ACO. Auteur et conférencier, il militait pour une science ouverte sur la société, abordant également les enjeux environnementaux et la transition écologique. Lauréat du Prix Félix-Robin (2001) et du Prix André Lagarrigue (2012), il laisse un héritage scientifique et humain durable auprès de la communauté scientifique.
Les lauréats et lauréates du prix
- 2025 : Abel Pires
Lauréat 2025

Abel Pires a débuté sa formation scientifique avec une Licence de Sciences Physiques à l’Université Paris-Est puis un Master 1 de Physique Fondamentale à l’Université Paris-Sorbonne. Il se dirige ensuite vers le domaine des accélérateurs avec un Master 2 Grands Instruments à l’Université Paris-Saclay, qui se termine par un stage sur l’accélération de paquet d’électrons ultra-courts par une onde THz guidée dans une structure diélectrique au Laboratoire Irène Joliot-Curie (CNRS, Orsay).
En octobre 2021, Abel Pires entame une thèse sur l’optimisation d’une source de rayons X par effet Compton Inverse sur un accélérateur linéaire d’électrons au laboratoire LEAR (Laboratoire ELSA et Applications des Rayonnements, CEA/DAM). L’accélérateur linéaire d’électrons ELSA du LEAR produit des électrons d’une énergie de 10 à 30 MeV utilisés entre autres pour la production de rayonnement X par diffusion Compton inverse avec un laser de puissance. Abel Pires s’est vu confier l’optimisation de cette source et son travail fut remarquable à plusieurs égards.
Tout d’abord, une source basée sur l’interaction entre un faisceau d’électrons relativistes et un faisceau laser ne peut être optimisée qu’avec une connaissance approfondie de la physique des faisceaux de particules chargées et de la physique des lasers. Abel Pires a su s’approprier en profondeur les concepts de ces deux physique. Mais Abel Pires s’est également attaqué aux aspects techniques de l’expérience, faisant rapidement preuve d’une grande maîtrise et d’une grande créativité. Abel Pires, loin de se perdre dans le spectre très large de la diversité des tâches à accomplir, a réussi avec brio à étudier en profondeur chaque aspect du problème.
Pour la partie laser, il a notamment proposé l’idée audacieuse de développer un système de CPA (Chirped Pulse Amplification). Avec des réseaux à la limite de l’état de l’art, il a conçu, réalisé et finalement validé le système. Mais il a également amélioré la conception mécanique, revisité le système opto-mécanique de repliement du faisceau laser et co-inventé un système d’alignement de faisceau laser reposant sur l’utilisation de valves optiques pour lequel une demande de dépôt de brevet a été déposée.
Abel Pires a aussi mené une étude très approfondie de la mesure d’émittance. En comparant de manière très fine différents codes numériques (TraceWin, RFTrack, CST Microwave Studio), il a démontré que les modélisations de TraceWin et de RF Track étaient insuffisamment réalistes pour rendre compte correctement le transport d’un faisceau dans des forts rayons de courbure tels que ceux rencontrés dans le double aimant alpha de l’accélérateur ELSA. Ces travaux ont une répercussion notable non seulement pour la source Compton étudiée, mais aussi pour la communauté, permettant de mieux cerner les domaines de validité des codes.
Le travail effectué par Abel Pires au cours de sa thèse est ainsi apparu comme remarquable par sa qualité, sa précision et la variété des concepts, méthodes expérimentales et codes de simulations numériques maîtrisés pour aboutir à l’objectif scientifique désiré.
L’ensemble de ces éléments a amené le jury à décerner le Prix Jacques Haissinski 2025 à Abel Pires.